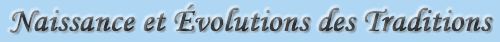
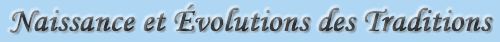
Le recrutement des futurs élèves des écoles d’Arts et Métiers s’est toujours voulu très populaire. Les enfants des classes élevées de la société profitent de l’enseignement, ainsi que les enfants issus des classes laborieuses pour qui l’école devient un ascenseur social. L’environnement familial, social, et culturel de ces jeunes a influencé de manière significative les Traditions.
Pour analyser ce recrutement, il convient de distinguer plusieurs périodes. La première correspond aux débuts de l’école. A ses origines, elle est destinée à recevoir les orphelins ou les enfants de soldats mutilés du régiment du duc. Le recrutement se fait donc essentiellement dans la classe militaire. Vient ensuite une période d’ouverture puisque entre 1810 et 1829, 27% des élèves sont fils de petits employés de l’administration, 23 % de militaires. Les élèves ainsi recrutés montrent peu d’aptitude pour des études techniques et finissent rarement dans l’industrie (ce manque de vocation chez les élèves a failli coûter la vie à l’école en 1830, sujette à de violentes critiques de la part du député Louis Arago ou en 1850 par l’attaque au Parlement par le biais d’une suppression de budget). La période 1830-1859 voit les débuts des chemins de fer et de la mécanisation de l’industrie. La réforme de 1832 place les écoles sous la tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie. Cela a pour conséquence de réduire la proportion d’élèves fils de militaires ou d’employés de l’administration (passant de 50 à 22%), au bénéfice de fils d’artisans, d’ouvriers qualifiés, de petits entrepreneurs. Entre 1860 et 1890, le pourcentage des pères fonctionnaires et militaires tombe encore, jusqu’à 13%. En revanche, le pourcentage de pères travaillant dans l’industrie triple (de 10 à 27%). Ces pourcentages reflètent la croissance industrielle et le déclin de l’artisanat. Et c’est dans le niveau social même que l’on trouve toute l’originalité du recrutement des Arts et Métiers. Le pourcentage des fils de contremaîtres et ouvriers de l’industrie passe de 2% au début du XIXe siècle à 27% à la fin de ce même siècle.
Étant donné le mode de recrutement de l’école, les classes qui y sont admises sont considérées par la bourgeoisie comme des « classes dangereuses ». Identiquement au schéma classique de l’industrie, l’administration de l’école cherche, tout au cours du XIXe siècle, à détruire la culture ouvrière des élèves et à les acculturer au mode de vie bourgeois. L’objectif de l’école est alors de fournir à l’industrie des cadres techniquement compétents et socialement sûrs, qui exécutent loyalement les ordres d’en haut et surveillent les ouvriers dans l’atelier. L’origine
sociale des élèves (peu d’aptitudes aux études
techniques, faible niveau scolaire) provoque à l’école
chahuts, révoltes et évasions. Les élèves
n’ont d’ailleurs pas peur à l’époque
du renvoi ni même de la prison de l’école, avec
son régime de pain sec et d’eau. Les trois quarts d’entre
eux n’ayant plus de parents ou n’ayant plus de contact
avec eux, l’école ne peut pas compter sur leur intervention
ni renvoyer les plus mauvais sujets dans leurs foyers. Jean-Jacques
Labâte, principal de l’école de Châlons
en 1808, attribue à leurs origines ce mauvais comportement
des élèves : On retrouve tout au long de l’histoire, de façon diminuée certes, ce chahut quasi chronique des élèves. Tantôt, ce sont les professeurs qui sont victimes des élèves, tantôt les surveillants ou d’autres catégories de personnel de l’école. De plus, la révolution industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle et la naissance du syndicalisme renforce chez les élèves le militantisme. Cet effet de groupe est démultiplié par le régime de vie de l’internat. Les écoles d’Arts et Métiers sont alors les seules écoles techniques en Europe à être des internats à financement public. L’internat, obligatoire de 1803 à 1964, repose sur le principe de la clôture séparant les élèves du monde extérieur. Un réel esprit de corps se forge à ce moment, calqué sur le mouvement syndical et reproduisant les conflits des classes dans l’industrie. Ce militantisme se retrouve aujourd’hui par un comportement souvent virulent des élèves vis à vis de l’administration. L’attachement à la classe ouvrière est présent depuis la création de l’école. Aujourd’hui encore il peut être caractérisé par le port de la biaude, à l’origine tenue dévolue au travail aux ateliers, maintenant symbole de l’esprit de corps des élèves et de cet attachement ouvrier. De nos jours,
cette culture de la simplicité des rapports se manifeste par
un mode de vie qui se veut franc, simple, dépourvu de tout
artifice de forme. |