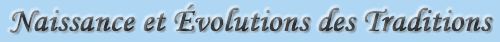
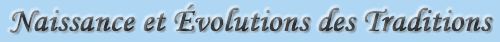
En 1780, le duc François-Alexandre-Frédéric de Liancourt, qui deviendra en 1792 duc de La Rochefoucauld-Liancourt, crée dans sa ferme de La Montagne une école pour instruire les orphelins de son régiment. Le duc, très lié aux philosophes de l’époque, inculquera à ses élèves une culture humaniste inspirée des Lumière. L’influence des philosophes Le duc est un homme de l’Encyclopédie, admirateur de l’industrie anglaise et du progrès technique. Il côtoie les Lumières dans les salons de sa tante, la duchesse d’Enville, où se réunissent les hommes les plus distingués dans les sciences et lettres, les étrangers les plus illustres et les hommes d’État les plus indépendants. Il en retient le goût pour la science appliquée « aux arts et métiers ». Il sent que toutes les idées émises doivent déboucher sur le concret. Par exemple, pour l’enseignement, il veut que le raisonnement vienne en aide à la pratique, en joignant « l’habileté de la main à l’intelligence de la science ».
 QUESNAY François (1694-1774) Député de la noblesse, le duc prend position en 1789 en faveur des idées révolutionnaires. Il préside même l’Assemblée nationale quand elle proclame lors de la célèbre Nuit du 4 août l’abolition des privilèges. Les excès de la Révolution l’obligent ensuite à émigrer aux États-Unis, mais il figure parmi les premiers nobles qui reviennent en France en 1799. Ses idées progressistes expliquent les trois disgrâces du duc sous trois règnes différents. Le scandale de ses obsèques (mars 1827), où la police de Charles X interdit aux Gadzarts (considérés comme des agitateurs politiques) de participer aux obsèques, illustre l’ampleur de l’opposition du régime de l’époque à ce personnage dangereux.  Nuit du 4 août 1789 Des projets à leur réalisation En 1775, le duc crée à Rantigny une tuilerie et une briqueterie. Dès 1780, il essaye la culture de la pomme de terre ; en 1788, il tente de détruire des jachères, si préjudiciables à l’agriculture française, en établissant dans ses domaines des prairies artificielles. Il fut un des fondateurs de la Société royale d’agriculture, instituée pour donner une direction scientifique au mouvement de régénération agricole, « pour venir au secours de la culture négligée des provinces éloignées ». Concernant son projet social, le duc invente, en 1780, la sécurité sociale pour les ouvriers de ses entreprises de tissage et de faïence : 150 ans d’avance ! Puis au début du XIXe siècle, il fonde la Caisse nationale d’épargne pour favoriser la prévoyance et le goût de l’économie dans les milieux populaires. Une retenue d’un cinquantième est faite sur la paye des ouvriers et la masse d’argent ainsi amassée leur permet, lorsqu’ils tombent malades, de percevoir le tiers du prix du travail ordinaire. Propagateur du vaccin antivariolique, il réforme les hôpitaux en y introduisant un véritable esprit de gestion. Il propose un plan de réforme pour humaniser la détention et viser à l’amendement des prisonniers. 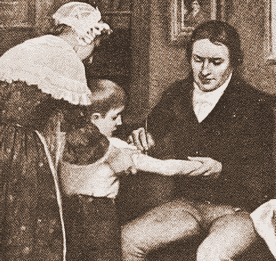 L’usage de la vaccine Enfin,
concernant le projet qui nous concerne plus particulièrement,
il ose prétendre que le savoir technique et le travail manuel
peuvent servir de fondement à un véritable humanisme.
Pour organiser son projet d’enseignement, il s’inspire
de ses nombreux voyages entre 1776 et 1779 en Angleterre, pays
montrant un intérêt certain pour les entreprises commerciales
et industrielles. Sa volonté est de faire sortir la France
de la routine professionnelle. Pour cela, il crée des ateliers
de tissage et de faïences et fonde dans sa ferme de La montagne
une école professionnelle copiée du modèle
anglais, école qui portera en 1803 le nom d’école
d’Arts et Métiers. Cette école est l’occasion
pour le duc d’appliquer les grands principes qu’il
défend. Il organise un enseignement pratique soutenu par
le savoir théorique. Cet enseignement est sans cesse teinté d’humanisme.
Ce sont d’ailleurs les hommes qui s’enrichissent de
leurs connaissances mutuelles puisque la formation est d’une
part dispensée par des professeurs, d’autre part,
ce qui constitue une nouveauté, dispensée par les élèves
les plus anciens : c’est ce qu’on appelle l’enseignement
mutuel. Cette coopération entre élèves préfigure
le parrainage d’une promotion à l’autre que
l’on connaît encore aujourd’hui. De plus, le
duc met en avant la valeur des arts mécaniques, l’élévation
que leur pratique peut favoriser chez les classes les plus laborieuses.
C’est la croyance dans le progrès des sciences et
techniques qui marquera dès lors et jusqu’à nos
jours les Écoles d’Arts et Métiers. |